8e exploration
Diplomatie parallèle
A propos d'un appel téléphonique passé le 19 mai 2020 et de quelques autres "anecdotes"
6 janvier 2021
Avertissement : les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie
Lire un résumé...
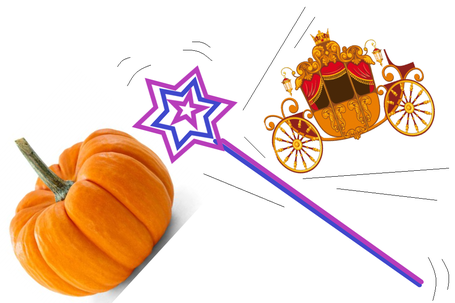
S’il existait des phénomènes qui ont des conséquences mais ni cause ni raison d’être, celui de la « diplomatie parallèle » pourrait bien en faire partie.
Mais foin de mystères, de quoi s’agit-il ?
On sait que Max Weber (1864-1920) définissait l’État comme un groupement qui a le monopole de la violence légitime. Mais a-t-il pareillement le monopole de la parole diplomatique, entendue comme parole légitime pour le représenter à l’extérieur ? Telle est la question posée dans cette 8e et dernière exploration, dont découle une définition simple de la « diplomatie parallèle », comme étant l’entreprise visant à rompre ce monopole.
Dans la tradition stato-centrée « westphalienne » des relations internationales, le monopole étatique de la violence légitime vaut à l’intérieur des frontières, tandis qu’à l’extérieur, c’est la concurrence des souverainetés qui prévaut. Cette règle non écrite est parfois remise en cause quand le monopole interne est menacé par des conflits de légitimité qui dégénèrent souvent en guerres dites « civiles ». Dans certains cas extrêmes, comme aujourd’hui encore (janvier 2021) en Libye[i], des forces concurrentes prétendent à l’exercice du pouvoir (donc au monopole de la violence légitime) sur un même territoire, dont chacune accapare une portion en attendant d’en conquérir la totalité.
Comme son nom l’indique, la parole diplomatique se trouve au carrefour de la parole et de la diplomatie, donc à l’intersection de deux ensembles plus vastes qu’elle : le premier englobe tous les actes de la communication, privés comme publics, issus de la société civile comme de la société politique, les premiers légitimés par le principe de libre expression et les seconds par la prétention à représenter l’État. Le second ensemble comprend tous les actes diplomatiques, définis comme des flux d’échange entre Etats pouvant prendre des formes plus ou moins « liquides » (cf. 1re exploration), depuis la plus simple déclaration jusqu’à l’acte de guerre. Ce qui caractérise un régime totalitaire est la prétention de l’État à détenir, au-delà du monopole de la violence légitime, celui de toute expression. Plus exactement, l’État refuse de faire la distinction entre la parole qui l’engage et celle qui reste privée. A l’extrême, toute communication engage l’État, et toute communication dirigée vers l’étranger est considérée comme une communication diplomatique, qui doit être contrôlée par l’État, quel qu’en soit l’émetteur.
En revanche, l’installation du pluralisme impose, sous peine de cacophonie, l’établissement d’une distinction claire entre la parole qui engage l’État et celle qui demeure privée.
La communication diplomatique est toujours un échange, qu’il porte exclusivement sur des mots ou que les mots s’échangent contre des flux moins liquides. Lorsque les partenaires de cet échange relèvent de régimes ou de cultures politiques différents, l’un reconnaissant le pluralisme des expressions et l’autre non, survient une difficulté qui a au moins le mérite de mettre en lumière un théorème capital selon moi :comme pour toute communication, la signification de la parole diplomatique dépend autant de son récepteur que de son émetteur et chacun d’eux en est responsable au même degré. On pourrait l’appeler le théorème de coresponsabilité dans la communication. Les dirigeants d’Etats totalitaires ne conçoivent pas que ce qu’ils interdisent chez eux soit autorisé chez leurs partenaires ; ils considèrent donc, ou font semblant de considérer toute critique en provenance d’un pays étranger comme engageant son gouvernement même si elle émane de personnes privées ou de médias indépendants. Ils ont donc tendance à demander des comptes à ces dirigeants, ce qui est susceptible, selon l’état du rapport des forces et la distribution des moyens de pression respectifs des deux partenaires du dialogue, de contribuer à miner la liberté d’expression dont l’un fait preuve. Dans un roman de Mario Vargas Llosa (44), l’ambassadeur d’Argentine au Pérou adresse une lettre de protestation à une radio privée sur les ondes de laquelle un animateur d’origine bolivienne est habitué à proférer des propos dénigrant les Argentins. « En Bolivie, on menaça même de rompre les relations diplomatiques », commente lui-même cet animateur avec une feinte indifférence, ajoutant qu’ « un libelle fit même courir le bruit d’une concentration de troupes aux frontières »[ii]. Cet état d’esprit peut, au-delà des seuls gouvernants, imprégner d’autres acteurs qui, même lorsque le pluralisme est formellement acquis chez eux, continuent d’intérioriser cette culture du monopole étatique de l’expression publique. C’est ainsi par exemple que l’on peut analyser la réaction du journal tunisien Le Temps à un article du New York Times qui critiquait la politique sécuritaire de la Tunisie après l’attentat de Sousse de juin 2015. Le journaliste tunisien écrit (15) : « Dans son éditorial du mercredi 8 juillet 2015, le New York Times tire à boulets rouges sur Beji Caïd Essebsi[iii]. Il prétend craindre que le chef de l’Etat tunisien profite de l’état d’urgence pour restreindre les libertés des Tunisiens… Le New York Times, étant un journal proche des milieux démocrates américains, cherche-t-il à mettre la pression sur la diplomatie tunisienne ? ». Les médias des pays dans lesquels le pluralisme de la presse est trop récent pour avoir imprégné la culture et être devenu une tradition peuvent être soupçonnés de remplir le rôle de porte-voix de leurs gouvernements. Par exemple, on peut lire dans une revue de presse de Courrier International, à propos de l’état de santé du président algérien Abdelmajid Tebboune, atteint de la Covid-19 en octobre 2020. : « Les médias marocains, qui font feu de tout bois pour discréditer le régime algérien, ont un ton alarmant. Le site Le360 fait ainsi observer que le communiqué de la présidence ne va pas jusqu’à “oser évoquer” des signes de rétablissement. » (2). Rappelant le contexte de « tensions accrues avec le Maroc, alors que les affrontements ont repris au Sahara occidental. », la rédaction de Courrier International établit donc un lien très clair entre la parole d’un organe de presse marocain d’une part et, d’autre part, la politique étrangère de ce pays. Dans un autre contexte géographique, un analyste russe de la fondation Carnegie explique pourquoi la Russie ne soutient l’Arménie que du bout des lèvres dans son conflit avec l ‘Azerbaïdjan à propos de la République autoproclamée du Haut-Karabagh. « L’Arménie, écrit-il, n’encadre pas la liberté des médias, ce qui a donné lieu à une recrudescence de publications critiques envers la Russie et élogieuses envers l’Occident. » (1) Dans son analyse, la liberté de la presse qui règne en Arménie est un facteur parmi d’autres qui influe (négativement) sur les relations qu’entretient ce pays avec la Russie.
Si la parole est libre mais que la distinction est floue entre celle qui engage l’État et celle qui ne l’engage pas, toute parole est potentiellement diplomatique ou en tout cas peut être considérée comme telle par tout ou partie des partenaires, avec plus ou moins de bonne foi. Le concept de « diplomatie parallèle » peut dès lors apparaître. On pourrait la définir dans une première approche comme une concurrence des expressions diplomatiques, qui surviendrait avec la liberté d’expression comme la concurrence économique naît avec la liberté d’entreprendre.
En effet, il s’agit bien de concurrence et non de complémentarité, et cela permet de distinguer la « diplomatie parallèle », (diplomatie non reconnue, diplomatie « au noir » en quelque sorte) de la subdiplomatie, qui désigne l’ensemble des diplomaties complémentaires de celle attribuée aux Etats et reconnue quelquefois par eux, au point d’être formalisée dans un cadre juridique constitutionnel : il s’agira de l’action à l’étranger des collectivités territoriales ou même des parlements (45).
En résumé, la communication du ressortissant d’un Etat relève de l’exercice d’une diplomatie parallèle si ce ressortissant s’adresse à des représentants d’un Etat étranger, s’il n’est pas mandaté par son propre gouvernement et, enfin, si le contenu de cette communication contredit la position officielle de ce gouvernement ou n’est pas coordonnée avec la sienne. Encore faut-il ajouter à ces trois critères une condition supplémentaire : que l’interlocuteur étranger auquel elle s’adresse la considère au contraire comme représentative. On ne peut parler de « diplomatie parallèle » que lorsque des individus non reconnus à l’intérieur comme représentants formels de leur pays se voient reconnaître une telle légitimité à l’extérieur, ce qui illustre une fois de plus l’importance du théorème énoncé plus haut de coresponsabilité.
Cette définition étant convenue, il devient possible de poser une question générale : quel éclairage l’observation des phénomènes désignés sous le terme « diplomatie parallèle » apporte-t-elle à l’analyse de la signification et du sens de la parole diplomatique ? Cette question sera approchée par petites touches, chaque réponse à une de ses déclinaisons suscitant la formulation d’une nouvelle déclinaison.
[i]Et ce, malgré le fragile cessez-le-feu signé le 23 octobre 2020.
[ii] p. 167-168
[iii] Président de la République tunisienne du 31 décembre2014 à son décès survenu le 25 juillet 2019
Première formulation
La première formulation concerne plus particulièrement le sens de la parole diplomatique (cf. « Les raisons pour lesquelles... ») et s’adresse aux tenants de l’approche réaliste des relations internationale : votre approche repose sur deux hypothèses ; la première est que la parole diplomatique ne tire son sens que de son association à des actes, qu’aucune parole n’a de sens si elle n’est pas accompagnée par des actes, que les prises de position diplomatiques ne doivent leur sens ou leur efficacité qu’à la possession de moyens de pression matériels ; la seconde en découle, selon laquelle, sur le plan de sa signification, la parole diplomatique n’est sincère que lorsqu’elle reconnaît cela et qu’elle est insincère lorsqu’elle prétend défendre d’autres enjeux que ceux qui relèvent de la froide et matérielle raison d’État.
Or, si les prises de position ne reflétaient que des enjeux matériels, pourquoi les représentants d’un Etat écouteraient-ils des individus qui, non détenteurs du pouvoir formel, ne peuvent rien leur garantir en termes d’enjeux matériels ? Si seuls l’intérêt et la raison d’État guidaient ces représentants, quelle motivation auraient-ils à traiter avec des acteurs dont ils savent qu’ils n’ont pas le pouvoir de les « payer », de réaliser de véritables transactions ? La conclusion réaliste est donc que, sans raison d’exister, la diplomatie parallèle n’existe pas. Les démarches qui sont dénoncées comme telle n’en relèvent pas ou doivent être minimisées. Ce ne sont que des mots. « Parole, parole ! ». C’est ailleurs que se jouent les affaires du monde.
Et pourtant, on en parle !
Pour des paroles qui n’ont aucune importance, celles-ci ne semblent pourtant laisser personne indifférent. Voilà une inexistence qui suscite beaucoup de commentaires, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Bref, on ne cesse guère de parler de ces paroles-là. On en parla lorsqu’un député français, Thierry Mariani, défraya la chronique dans la décennie 2010 par les nombreux voyages qu’il entreprit dans le but de nouer des contacts avec des dirigeants étrangers pourtant boudés par le gouvernement de son pays, comme le Syrien Bachar El-Assad. « “Il fait partie de ces parlementaires qui aiment que l’on parle d’eux et qui ont compris que la politique des coups est efficace, quitte à développer une diplomatie parallèle” », estime Thomas Gomart, chercheur à l’Institut français des relations internationales. » (4)
Plus récemment, le chroniqueur Pierre Haski évoqua le concept de diplomatie parallèle pour qualifier les démarches du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, visant au rapprochement du royaume avec l’État d’Israël, alors même que son père, détenteur officiel du pouvoir, était plus timoré sur la question. « Il ne s’agit pas, explique-t-il, comme avec les Émirats arabes unis et Bahrein, de reconnaissance diplomatique : c’est impossible tant que le vieux Roi Salman est vivant, il refuse sans accord sur les droits des Palestiniens. Mais le jeune Prince n’est pas sur la même ligne, et mène sa diplomatie parallèle, ... » (32)
Même des initiatives en apparence autrement plus anodines que celles-ci, telles que les opérations de jumelage entre communes européennes, font l’objet de la part de l’exécutif, en France mais sans doute ailleurs, de soupçons au titre de cette fameuse « diplomatie parallèle », surtout quand des maires s’avisent de s’associer avec des localités appartenant à des territoires encore non reconnus en tant qu’Etats, comme la Palestine ou le Haut-Karabagh (43).
Mais pour explorer ce mystère de la diplomatie parallèle, je m’appuierai plus particulièrement sur quelques exemples puisés dans l’histoire récente de la Tunisie.
Gros plan sur une illustration tunisienne
Le 19 mai 2020, Rached Ghannouchi décrocha son téléphone, pour féliciter Fayez Sarraj qui, la veille, venait de reprendre aux forces de Khalifa Haftar la base aérienne d’Al-Watiyah en Tripolitaine (6). L’initiative fut rendue publique par un communiqué de la présidence du gouvernement Sarraj en date du 19 mai (24).
Qui est Rached Ghannouchi ? C’est le leader du mouvement islamiste tunisien Ennahdha (souvent qualifié d’ « islamo-conservateur ») qui, par ailleurs, depuis le 13 novembre 2019, préside l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple), que la constitution de 2014 a créée pour représenter le pouvoir législatif en Tunisie.
Qui sont Fayez Sarraj et Khalifa Haftar ? Deux prétendants rivaux au pouvoir sur le territoire de la Libye. Le premier est reconnu par l’Onu, soutenu par le Qatar et la Turquie et dirige un « Gouvernement d’Accord National » (GNA) qui contrôle Tripoli et la portion occidentale du pays ; le second est appuyé par l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, et bénéficie de la sympathie des gouvernements russe et français. A la tête d’une « Armée Nationale Libyenne » (ANL), il contrôle la partie la plus orientale du territoire libyen (cf. 7e exploration).
S’il déclencha une levée de boucliers en Tunisie, ce coup de téléphone n’était pas un acte isolé ; il s’inscrivait dans une série de contacts que le leader d’Ennahdha s’efforçait de nouer à l’étranger, de préférence avec des gouvernements inspirés par la même mouvance idéologique, celle des Frères Musulmans. Dans la foulée des élections législatives du 6 octobre 2019 qui l’avaient propulsé à la tête de l’ARP, il se rendit en Turquie pour y rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, puis de nouveau le 11 janvier 2020, à Istanbul, en même temps d’ailleurs que le leader libyen Fayez Sarraj (35) ; d’autres contacts furent organisés par le leader d’Ennahdha, notamment avec les dirigeants du Qatar (participation à une conférence internationale organisée en mars 2020 par cet émirat) (41), mais aussi de la Russie (dont il rencontra l’ambassadeur Sergey Nikolaev, le 8 janvier 2020, au palais du Bardo (9) (siège du parlement tunisien). Selon le journal Le Temps, Ghannouchi aurait « multiplié » les rencontres avec Erdogan et Sarraj (25). D’autres sources mentionnent les conversations téléphoniques que tint le leader d’Ennahdha, le 5 mai, avec Khalid al-Mishri, président du Haut Conseil d’État libyen (38), et quelques jours plus tôt avec Recep Tayyip Erdogan soi-même (39).
En sa fonction de président du parlement tunisien, Ghannouchi créa la polémique en avril 2020, en tentant de mettre à l’ordre du jour, dans un contexte de crise sanitaire, des projets de loi renforçant la coopération avec la Turquie et le Qatar. Le premier visait l’approbation d’un accord de coopération que l’exécutif tunisien avait déjà signé avec Ankara le 27 décembre 2017 ; le second portait sur l’approbation de l’ouverture du siège d’un fonds de développement qatarien (« Qatar Fund for Development »).
Dans toutes ces démarches, il fut vivement critiqué, comme cela était prévisible dans une société qui demeure divisée sur la place du religieux dans la vie civile et, par conséquent, sur la politique des alliances internationales qui peut en découler. Mon propos n’est pas d’argumenter sur le fond de ces débats, mais de réfléchir sur l’utilisation du « concept » de « diplomatie parallèle », qui en constitua une sorte de leitmotiv quasi permanent bien qu’inégalement explicite, comme le résume un titre de La Libre Belgique : « Le parti islamiste tunisien est accusé de “diplomatie parallèle” en faveur d’Ankara » (29), tandis que Le Monde commenta : « Ces derniers mois, M. Ghannouchi s’est ingénié à intimider le chef de l’Etat, voire à le ridiculiser, en marchant notamment sur ses plates-bandes dans le domaine des affaires étrangères, une prérogative du président. ...Mais ces tentatives de déstabilisation et sa diplomatie parallèle lui ont valu une forte hostilité au sein du Parlement, sans vraiment parvenir à ébranler le chef de l’Etat. » (7)
Mais c’est surtout dans la presse tunisienne que, du fait de sa proximité avec le sujet, on peut relever le plus de citations renfermant cette expression. Ainsi, à propos du voyage à Istanbul du 11 janvier 2020 : « De nombreux députés ont également accusé le président de l’ARP de mener une sorte de diplomatie parallèle en l’absence d’une politique diplomatique claire en Tunisie. » (10)
Certains commentateurs assimilent la diplomatie parallèle à une diplomatie complémentaire de la diplomatie officielle, preuve que le concept, s’il est défini dans les manuels, n’est pas fixé par l’usage y compris médiatique. Cela ne les empêche pas de dénoncer les agissements de Rached Ghannouchi, qu’ils considèrent comme des transgressions dépassant en gravité leur conception de la diplomatie parallèle : « Certes, les médias, la société civile sont des acteurs qui peuvent jouer un rôle pour amplifier la voix de la Tunisie ou pour prendre position contre l’attitude de notre pays sur un dossier, mais cela reste du domaine de la diplomatie parallèle qui, même si elle représente une gêne pour le régime en place, ne lui fait endosser aucune responsabilité. Mais quand c’est le président du Parlement qui... interfère dans la politique étrangère de notre pays, c’est une usurpation de pouvoir qui peut nuire grandement à la nation… » (11) On voit en lisant ces lignes que la transgression que l’auteur dénonce sans la nommer correspond exactement à la définition que je propose de la diplomatie parallèle.
Le journal Le Temps, autre grande voix francophone des médias tunisiens, n’est pas en reste. Rached Ghannouchi y est pareillement présenté comme le « ...fondateur d’une politique étrangère parallèle… » (20), que l’auteur oppose à une « diplomatie centralisée », dont, en mai 2020, il salue le retour, à la faveur, selon lui, d’une reprise en mains de la politique étrangère par le président de la République : « …, la Tunisie reprend sa diplomatie centralisée, … Désormais, aucune dissonance n’est plus de mise. … »
Enfin, L’Economiste maghrébin résume : « Pour avoir félicité Fayez Sarraj, suite à la récupération d’une base militaire proche des frontières tunisiennes, les détracteurs de Rached Ghannouchi l’accusent d’avoir franchi le Rubicon. Et ce, en s’alignant sur l’un des belligérants du conflit libyen. Menant ainsi une diplomatie parallèle à la ligne officielle observée par l’Etat tunisien. » (28)
La polémique culmina au sein du parlement tunisien, lors du débat organisé le 3 juin 2020 à l’ARP ; il fut suivi d’un vote sur une résolution dénonçant « toute intervention étrangère en Libye », déposée par le bloc parlementaire destourien du PDL (Parti Destourien Libre), mais qui n’obtint pas la majorité. Enfin, le 30 juillet, l’assemblée fut à nouveau appelée à s’exprimer sur une motion de défiance à l’égard de Rached Ghannouchi, elle aussi finalement rejetée après avoir réuni les voix de 97 députés sur 217.
Il conviendrait cependant de nuancer ce réquisitoire sous deux aspects : d’abord, Ghannouchi n’a pas contacté uniquement des acteurs de son camp, puisque par exemple, dans le sillage d’une initiative tunisienne officielle visant, à partir de septembre 2016 (16), à participer avec les pays voisins, à une médiation entre les parties libyennes en conflit, il rencontra le président algérien Abdelaziz Bouteflika en janvier 2017 (17) ; plus récemment, le 8 février 2020, c’est Aguila Salah, le président du parlement de Tobrouk, contrôlé par Khalifa Haftar, qui s’est entretenu avec lui à Amman. A noter d’ailleurs que cette rencontre a éveillé les mêmes soupçons que les autres (13). Ensuite, il n’est pas le seul acteur à nouer des contacts à l’étranger sans en avoir été prié par l’autorité légitime. Ainsi, le journal Le Temps signale-t-il une rencontre à Benghazi entre le Libyen Khalifa Haftar et le Tunisien Mohsen Mazrouk, leader du parti Machrou Tounes, le 24 février 2017. Cette initiative suscita des protestations (18) et une mise au point du président Béji Caïd Essebsi (19). On ne peut donc pas soupçonner les protestataires de ne viser que le camp islamiste et de ne condamner, au nom du rejet de la « diplomatie parallèle », que les contacts noués avec le camp libyen soutenu par ces islamistes.
Deuxième formulation
Donc, contre toute attente réaliste et rationaliste, non seulement les démarches étiquetées comme relevant de la diplomatie parallèle font couler beaucoup d’encre et de salive, mais surtout, elles ne laissent personne indifférent, font scandale et sont prises très au sérieux par les acteurs étatiques de premier plan. Si ces démarches sont si anodines, pourquoi les gouvernements sont-ils si soucieux de les dénoncer, de verrouiller leur parole diplomatique, de renier toute parole concurrente, de la condamner en tant que diplomatie parallèle et de neutraliser les démarches qui en relèvent ? Bref, réalité ou pas, la diplomatie parallèle fait l’objet d’une représentation qui constitue en tant que telle un phénomène bien réel, qu’on ne peut ignorer et qu’on doit essayer de comprendre.
Face aux limites d’une approche réaliste et exclusivement rationaliste de la question, voyons si, à l’opposé, une réponse idéaliste serait plus satisfaisante.
Que donnerait un regard idéaliste ?
D’abord, la vision idéaliste survalorise la responsabilité et le rôle des individus dans l’Histoire, au détriment des structures. Une entreprise qui fait faillite est une entreprise qui est mal gérée, quelle que soit la conjoncture. De même, un Etat qui fait la guerre, ou un Etat - pire - qui perd la guerre est un Etat mal dirigé, donc mal représenté. La diplomatie parallèle n’est qu’un cas extrême et particulier de mauvaise représentation ; particulier parce qu’il est question de sa représentation à l’étranger ; extrême parce que la représentation est non seulement mauvaise mais fausse : c’est une usurpation d’identité.
Ensuite, l’approche idéaliste survalorise le rôle de la parole. Un idéaliste est toujours persuadé qu’on peut résoudre les conflits par la parole, en tentant de convaincre l’adversaire. La parole est donc dotée d’un pouvoir intrinsèque, relativement peu dépendant de la pertinence de son contenu, mais qui dépend, en revanche, outre leur éloquence personnelle, du statut des locuteurs, c’est-à-dire de leur représentativité. Au nom de qui parlent-ils ? C’est ce critère formel de représentativité qui, en même temps qu’il sert de définition en creux à la diplomatie parallèle, insuffle à la parole diplomatique un caractère magique. La représentativité donne à cette parole une onction qui en fait une parole officielle, comme une baguette magique transforme une citrouille en carrosse. C’est ce qui rend de ce point de vue la diplomatie parallèle moralement condamnable, car constituant un abus de confiance d’autant plus grave que cette confiance est un a priori dans cette approche.
En Tunisie, c’est cette approche formelle qui fournit une argumentation d’ordre juridique permettant de condamner les démarches de Rached Ghannouchi à l’étranger. Dès lors que Ghannouchi exprimait à l’étranger des positions s’éloignant de la ligne officielle gouvernementale, qu’il le faisait en tant que président d’une assemblée dotée du pouvoir législatif et donc engageant l’État tunisien, il outrepassait son rôle parce que ces démarches relèvent de la diplomatie, et que la constitution tunisienne de 2014 réserve ce domaine au chef de l’État et au ministre des Affaires étrangères. La diplomatie parallèle était ainsi caractérisée.
Il y a cependant dans l’appréciation de ces critères une part de subjectivité que permet d’éclairer la comparaison entre différentes perceptions médiatiques des initiatives de Rached Ghannouchi. En janvier 2017, il rencontrait à Alger le président Bouteflika dans le cadre de l’initiative tunisienne sur le conflit libyen. Pour Le Temps, « ce genre de pratique peut, …, nuire à l’État, à sa diplomatie… D’ailleurs », ajoute le journaliste, « la présidence du gouvernement vient tout juste de publier une note appelant tous ses fonctionnaires à se soumettre au règlement lorsqu’ils souhaitent s’entretenir avec des responsables étrangers et de ne le faire qu’après accord et autorisation spéciale de la part du ministère des Affaires étrangères qui doit, à son tour, désigner quelqu’un pour faire partie de la rencontre… » (17) Le Monde en revanche, qui mentionne une rencontre organisée le même mois par Ghannouchi à son domicile de Tunis avec le chef de cabinet du président algérien ainsi qu’avec un leader libyen du camp islamiste, salue une « particularité tunisienne » : « le président Béji Caïd Essebsi, issu du camp “moderniste”, œuvre de concert avec Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste Ennahda, qui a accepté de mettre ses liens avec les islamistes libyens au service de l’initiative tripartite. » (5)
La question était donc de savoir quelle « casquette » Ghannouchi utilisait à l’étranger. Elle fit l’objet d’une grande partie de la discussion parlementaire qui eut lieu à l’ARP où il fut auditionné le 15 janvier 2020 au sujet de sa visite à Istanbul du 11 janvier. Les représentants d’Ennahdha se défendirent en faisant valoir que leur leader s’y était rendu à titre personnel, ou plus exactement, « au nom du parti » (10) et qu’en outre, il tenait le président de la République informé de démarches qui, par ailleurs, étaient au diapason de la politique étrangère tunisienne : le président de la République Kaïs Saïed n’avait-il pas lui-même accueilli M. Erdogan à Tunis le 25 décembre 2019 lors de ce qui fut qualifié d’une « visite-surprise » ? (35) D’autres s’en allèrent fouiller dans le règlement intérieur d’Ennahdha pour montrer que, Ghannouchi ne pouvant porter deux casquettes à la fois, c’est bien celle de président de l’ARP qu’il avait sur la tête à Istanbul le 11 janvier. « Au terme du règlement intérieur du parti son président doit être responsable au sein du parti à plein temps et ne peut par conséquent exercer aucune autre fonction à l’extérieur de son parti. ... Cela signifie que légalement (que) Ghannouchi n’est plus le Président d’Ennahdha et par voie de conséquence, sa visite en Turquie ne peut être effectuée qu’en sa qualité de Président du parlement. » (36)
Le message téléphonique de félicitation que Rached Ghannouchi adressa le 19 mai 2020 au leader libyen Fayez Sarraj suscita, dès le 21 mai, de vifs débats au sein de l’ARP, où sept partis politiques jugèrent son attitude « inadéquate avec sa fonction à la tête du Parlement », l’accusant « d’outrepasser les institutions de l’Etat, de les impliquer dans le conflit libyen aux côtés des Frères musulmans » et « de privilégier « l’intérêt des Frères musulmans à ceux de la Tunisie » (41). Rappelons toutefois que le « bloc » parlementaire PDL d’Abir Moussi ne parvint pas, le 4 juin, à réunir une majorité pour condamner les agissements du leader d’Ennahdha au sujet de la guerre en Libye (31).
Dans l’optique idéaliste, si la diplomatie parallèle est un abus de confiance, elle peut être réparée : une parole fausse illégitime peut être corrigée par une autre parole, vraie parce que sortant d’une bouche représentative. Ceci pourrait être illustré à propos d’une entreprise dite de « diplomatie sanitaire », que la Turquie et le Qatar tentèrent de mettre en œuvre en Tunisie et dans laquelle Rached Ghannouchi fut soupçonné de jouer un rôle d’intermédiaire. Dans le contexte de la pandémie de covid-19, la « diplomatie sanitaire » (selon l’expression employée par le journal Le Temps) pourrait être définie comme une communication diplomatique, donc un ensemble de messages se distinguant par leur structure sémiologique et par la nature de leur récepteur, davantage que par leur contenu en termes de signification. Sur le premier point, il s’agit de messages connotés, dont le signifiant est un acte – une aide matérielle de nature médicale – et qui s’adresse vraisemblablement – et c’est le second point, à l’opinion publique plutôt qu’à des acteurs de la diplomatie.
Ainsi, la Turquie expédia en Tunisie et en Libye une aide médicale qui, si l’on en croit le journal Le Temps, était tout sauf désintéressée, la première venant monnayer implicitement le soutien diplomatique tunisien, la seconde servant très concrètement de paravent à une aide militaire aux forces de Faïez Sarraj. De plus, selon la même source, l’interlocuteur tunisien de cette diplomatie fut au premier chef le président de l’ARP, qui joua un rôle déterminant dans la réception de l’aide. « Un avion turc, résume magnifiquement Slim Ben Youssef, en cache toujours un deuxième » (21). Selon lui, l’atterrissage d’un premier avion turc chargé d’une cargaison d’aide médicale destinée à la Tunisie, accueilli « en fanfare » par le président de l’ARP ainsi que par un ministre de la Santé - par ailleurs et fort opportunément membre d’Ennahdha fut suivi à quelques jours de là d’un second atterrissage, à Djerba, destiné à aider, lui, la Libye voisine, « ou plus précisément le régime de Sarraj ».
Mais, explique encore Le Temps, le président de la République tunisienne finit, certes tardivement, par reprendre en mains les rênes de la diplomatie, « réparant » en quelque, de manière symbolique, pour ne pas dire magique, les dégâts de la diplomatie parallèle et les atteintes, pourtant matérielles, à la souveraineté tunisienne (des avions turcs ayant survolé l’espace aérien de la Tunisie et surtout foulé le sol tunisien en atterrissant sans autorisation officielle sur certains de ses aéroports). En d’autres termes, pour que des démarches relevant de la diplomatie parallèle fussent « réparées », il suffisait que la diplomatie officielle les reprît à son compte. Comment cela s’est-il passé ? En prenant en charge, « sur instructions présidentielles », à sa sortie de l’avion turc, la cargaison de médicaments, l’administration tunisienne a en quelque sorte effacé une réalité humiliante, à savoir le fait que l’aide médicale concrétisée par cette cargaison n’avait pas été négociée par le gouvernement tunisien mais par Ennahdha. De même, en inaugurant le nouvel hôpital financé par le Qatar à Kébili, le président de la république gommait le rôle joué par Ghannouchi dans la négociation de cette aide (22). La diplomatie parallèle ? Il suffit de se boucher les yeux pour la faire disparaître.
En réalité, l’approche idéaliste de la question n’est pas beaucoup plus satisfaisante que la conception réaliste ; elle doit être dépassée à son tour, tout simplement parce que sa définition formelle de la diplomatie parallèle est incomplète : si elle intègre bien les trois premiers critères énoncés en introduction, elle oublie le quatrième, pourtant essentiel : la coresponsabilité de l’émetteur et du récepteur des messages diplomatiques. La diplomatie parallèle n’est pas synonyme d’usurpation d’identité, à partir du moment que les interlocuteurs de ceux qui s’y adonnent savent parfaitement que ceux-ci n’ont pas été mandatés par leurs gouvernements. En particulier, dans chacune des démarches de Ghannouchi, le juge de paix n’est autre que son interlocuteur. Si ce dernier considère qu’il a reçu un représentant de l’État tunisien, alors cet Etat est engagé de fait. Par exemple, à la suite de sa rencontre de janvier 2020 avec le leader d’Ennahdha, l’ambassadeur russe a souligné, d’après un communiqué de l’ARP, « la convergence des points de vue de la Tunisie et de la Russie sur la crise libyenne » (9) ; de la Tunisie, pas de Rached Ghannouchi ; de la Russie, pas de Sergey Nikolaev. Au lieu de mettre en valeur une quelconque qualité des relations personnelles qu’il aurait entretenues avec M. Ghannouchi, (et dont on ne voit pas très bien quand et comment elles auraient pu se développer) ce sont bien des relations d’État à Etat qu’il a évoquées à l’issue de cet entretien. Cela semble donc apporter de l’eau au moulin de ceux qui pointent du doigt dans cette rencontre un exemple de diplomatie parallèle.
Peut-on dire pour autant qu’il y avait usurpation d’identité ? Il faudrait pour cela que l’ambassadeur russe ignorât alors le véritable statut de Rached Ghannouchi et son illégitimité à représenter à lui tout seul l’État tunisien. Personne ne peut sérieusement imaginer une telle ignorance. Si cet ambassadeur - et derrière lui le gouvernement russe - voulaient voir en lui un représentant de l’Etat tunisien, ils en portaient seuls la responsabilité. Cette hypothèse de lucidité peut être d’autant plus raisonnablement étendue à l’ensemble des interlocuteurs de Ghannouchi qu’à la différence de celui-ci, ils ne faisaient pas tous semblant de croire en sa représentativité.
Autrement dit, si la diplomatie parallèle ne trompe personne, elle n’a pas lieu de faire scandale. Or, scandale il y a. Ceux qui en parlent attribuent au phénomène un sens moral qui conduit à le condamner ou à le dénoncer. L’expression est péjorative.
Puisque la diplomatie parallèle ne trompe personne, sa condamnation ne relève pas d’une problématique de la signification de la parole diplomatique, qui, rappelons-le, concerne sa crédibilité, son degré de sincérité. Peut-être faut-il alors, pour tenter de comprendre l’existence de cette représentation et son caractère scandaleux, aborder la question sous l’éclairage du sens de la parole diplomatique.
A la recherche du sens de la diplomatie parallèle
L’approche idéaliste de la question du sens est morale. Mais ne nous y trompons pas : si le mot est péjoratif, la chose, selon le point de vue adopté et les cas abordés, peut être soit condamnée soit au contraire justifiée par les tenants de cette même approche. Par exemple, au nom de la défense de la cause des peuples opprimés, il leur arrive non seulement de justifier mais de la mettre en pratique ; on peut donner comme exemples un certain nombre de procédures de jumelages de villes françaises avec des entités non reconnues officiellement comme des Etats. « La connaissance de l’autre est la première pierre d’une maison commune et pacifiée », écrit Christian Renaud (43). Rien de plus idéaliste que cette sentence introductive, que l’auteur considère comme l’idée-force à l’origine du phénomène des jumelages. Mais il souligne que « certains jumelages ou chartes d’amitié soulèvent parfois la controverse », comme ceux qui lient symboliquement des communes françaises avec des « entités » palestiniennes ou des localités de la République autoproclamée du Haut-Karabagh, en Azerbaïdjan. Entrant en contradiction avec la politique étrangère de la France, plusieurs de ces chartes ont été annulées par la justice administrative[i]. Dans ce cas particulier, la condamnation repose sur une variante du critère formel de la représentativité, qui est la non-reconnaissance. Ce ne sont pas des individus qui sont jugés incompétents pour représenter des entités, mais les entités elles-mêmes qui sont non-reconnues en tant que personnes morales dotées du droit à conduire une politique internationale. Il est intéressant de constater ici que les deux parties à cette controverse judiciaire française (villes incriminées d’un côté, État de l’autre) argumentent d’une manière aussi abstraite l’une que l’autre, la première au nom de l’idéal internationaliste, la seconde en vertu du formalisme juridique, et que leurs conclusions s’opposent l’une à l’autre. Aucune des deux parties toutefois ne se revendique ouvertement de la diplomatie parallèle.
Il en est de même en ce qui concerne les controverses tunisiennes au sujet de la pratique internationale du leader d’Ennahdha, Ceux qui condamnent cette action le font au nom de ce qu’ils considèrent relever en elle de la diplomatie parallèle ; ceux qui l’approuvent le font en niant le caractère parallèle de cette « diplomatie ».
Pour un réaliste en revanche, l’approche du sens de la parole diplomatique n’est pas morale mais pratique. A la question du droit des individus à parler au nom des Etats se substitue alors celle de la portée et des effets de leur parole. C’est la raison pour laquelle, au-delà du non-respect du critère formel de représentativité, c’est au nom de ses potentielles conséquences concrètes que l’action de Rached Ghannouchi a soulevé la polémique et suscité l’indignation d’une partie de l’opinion et de la classe politique tunisienne.
[i] Par exemple, celles liant à des localités du Haut-Karabagh aux villes de Valence, Alfortville et Villeurbanne (décision du 17 octobre 2019)
Un message aussi lourd de sens que dénué de signification ?
Le grief d’atteinte à la sécurité nationale a été utilisé pour condamner, au-delà de l’appel téléphonique du 19 mai 2020, l’ensemble des agissements de Rached Ghannouchi. « Au début de l’année, les appels à retirer la confiance à Rached Ghannouchi se sont multipliés après sa visite en Turquie, en janvier, et sa rencontre à huis clos avec le président Recep Tayyip Erdoğan. Sa participation en mars dernier à une conférence internationale organisée par le Qatar avec des Frères musulmans a accentué la pression, et il est désormais accusé de mettre en danger la sécurité nationale tunisienne par ses prises de positions. » (41)
Quelle portée pouvait avoir ce coup de téléphone ?
Si cette portée ne devait dépendre que de son contenu en termes de signification, elle se réduirait à zéro. Rien de plus anodin en effet que cet appel : aucune importance concrète, aucune capacité à modifier le rapport des forces militaires en Libye. S’il eut des conséquences c’est, comme on l’a vu, sur le débat politique interne en Tunisie, et il s’agit davantage, pourrait-on dire, des conséquences de l’idée du coup de téléphone que de sa réalité : à la limite, si Rached Ghannouchi n’avait jamais décroché ce téléphone et s’il s’était contenté d’annoncer l’avoir fait, elles eussent été les mêmes. (D’ailleurs, qui prouve que le coup de téléphone a bien été passé ?) Annoncer publiquement : « j’ai félicité M. Sarraj », cela revient à le féliciter effectivement, que le téléphone ait été effectivement décroché ou non. En effet, le destinataire des félicitations n’aurait pas disposé de moins d’information sur le contenu d’un message de toute façon sans contenu. Et à vrai dire, des félicitations partagées publiquement, même sans conversation téléphonique, valaient mieux (possédaient plus de crédibilité) que ces mêmes félicitations, murmurées sans témoin sur une ligne téléphonique.
Ce message, en effet, en tant que message de félicitation, n’avait par définition aucun contenu informatif. Il n’exprimait pas davantage de point de vue sur ce que son destinataire avait à faire, devait faire, aurait intérêt à faire, il ne fournissait aucun conseil susceptible d’influer, si peu que ce fût, sur la suite des événements... Il relevait du mode performatif : son auteur félicitait comme un maire marie, comme un juge condamne, comme un commissaire place un suspect en garde à vue ou comme un préfet arrête l’obligation de porter un masque dans un espace public. Les messages performatifs ne valent que par la reconnaissance par leurs destinataires de leur légitimité et, accessoirement, par les moyens de coercition que leurs auteurs ont la capacité de déployer pour leur mise en application. En l’occurrence, la coercition n’est pas de mise : l’auteur de félicitations n’a nul besoin de l’assentiment de leur destinataire pour que ces dernières s’appliquent : ce dernier est, pourrait-on dire, placé devant le fait accompli.
En fait, semblable à ces coups de fusil qui par le recul blessent le chasseur au lieu de tuer le lapin, ce message eut davantage de répercussions sur son auteur que sur son destinataire.
Dans ces conditions, accuser Rached Ghannouchi d’atteinte à la sécurité nationale en raison de ce coup de téléphone revenait à imaginer que le camp du maréchal Haftar serait tenté de « punir » une Tunisie qui, à cause des démarches de diplomatie parallèle, aurait rompu sa tradition de neutralité. « Puisque la Tunisie se donne ainsi les apparences de soutenir verbalement mon ennemi, je vais punir la Tunisie. Et je vais le faire d’une façon matérielle, voire militaire. C’est ce que sous-entendrait, par exemple, s’il fallait le prendre à la lettre, ce plaidoyer d’un avocat tunisien paru dans le journal La Presse : « Ces “félicitations” adressées à un chef de camp contre un autre peuvent avoir des conséquences irrémédiablement néfastes sur les relations tuniso-libyennes, considérées à juste raison comme un exemple d’amitié, de coopération et de fraternité entre les peuples. ». Et un peu plus loin : « …, le président de la République est sûrement conscient du fait que Rached Ghannouchi vient de mettre la sécurité de la Tunisie et du peuple tunisien en péril. N’a-t-il pas pensé un instant à ce que serait la réaction de nos frères libyens si demain les forces du maréchal Haftar prenaient le dessus ? » (12)
Cet argument pèche pourtant sur trois points : d’abord, il accepte une incohérence, celle consistant à prévoir que des actes puissent répondre à des paroles. Certes, l’incohérence n’est jamais impossible, mais il n’y a pas de raison de la poser a priori. On pouvait facilement s’attendre à ce que la parole diplomatique du camp Haftar réponde sous la forme de protestations à ce qui eût été perçu comme une parole diplomatique tunisienne hostile ; il semble peu convaincant, en revanche, d’imaginer une réponse disproportionnée, donc militaire, à un message sans enjeu, comme montré précédemment. Ensuite, l’argument suppose que les interlocuteurs étrangers considèrent les démarches de Ghannouchi comme engageant effectivement l’État tunisien. Or, tous, tant Sarraj que Haftar, sont informés ; ils connaissent le statut de leur interlocuteur ; ils savent mesurer ses prises de position à l’aune de ce statut et, à l’opposé, ils identifient parfaitement les Tunisiens dotés de la légitimité à représenter leur pays, dont ils connaissent les positions.
En résumé, les deux griefs qui sont censés fonder ici l’accusation de diplomatie parallèle, le critère formel de la représentativité et le grief qui se veut réel de l’atteinte à la sûreté nationale ont en commun et contre eux l’oubli du « théorème de coresponsabilité » : le sens et la signification des messages diplomatiques (comme de tous les messages) sont fabriqués autant par le destinataire que par l’émetteur.
Enfin, le troisième péché du grief d’atteinte à la sécurité nationale consiste à imaginer que la stratégie du maréchal Haftar allait être modifiée par des flux diplomatiques purement symboliques comme ce coup de téléphone de Ghannouchi à Sarraj. Ou bien Haftar considérait que la politique de la Tunisie nuisait à ses intérêts concrets, et dans ce cas personne ne pouvait douter qu’il chercherait à pallier tout aussi concrètement cet état de fait, sans avoir besoin d’un quelconque appel téléphonique pour le faire ; ou bien il considérait que ce n’était pas le cas, et aucun message de félicitation adressé par qui que ce fût à qui que ce fût n’avait de raison de changer cette appréciation.
Ce qui est remarquable, c’est que l’énoncé de ce troisième péché prend l’approche réaliste en flagrant délit de contradiction puisque le même réalisme conduit à se soucier des conséquences concrètes d’une action diplomatique ou pseudo-diplomatique et dans le même temps à conclure rationnellement que ces conséquences n’ont pas de raison d’être.
Inversement, le même raisonnement disqualifie un argument, que le leader d’Ennahdha utilisa pour sa défense, selon lequel son appel du 19 mai 2020 pouvait en soi constituer un atout économique et social pour les Tunisiens : « Ghannouchi a indiqué que “l’entretien avec Al-Sarraj, chef du gouvernement libyen d’entente nationale était à l’initiative de ce dernier et pourrait être considéré comme un visa pour la Libye pour les travailleurs, les commerçants, les agriculteurs, les entrepreneurs et les hommes d’affaires tunisiens” » (14). Si la relation entre cet appel téléphonique et la stratégie militaire ne va pas de soi, ce serait une entreprise encore plus ambitieuse et hasardeuse que d’échafauder une chaîne de causalité entre ce flux diplomatique symbolique et les flux économiques à venir découlant de ce qu’il est convenu d’appeler la « reconstruction » de la Libye [i]
[i] A propos des retombées que l’on imaginait en 2015 de la signature de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien
Un cheval de Troie au Bardo ?
Cependant, il ne faudrait pas que l’ « appel du 19 mai » soit l’arbre qui cache la forêt ; s’il ne comportait pas d’enjeu concret, peut-on en dire autant de l’ensemble des rencontres et contacts noués par Rached Ghannouchi avec les dirigeants turc, qatari et libyens et qui ont été énumérées plus haut ?
En résumé, au-delà du grief d’atteinte à la sécurité nationale, l’opposition à Ghannouchi l’accuse de se comporter en « cheval de Troie » de la Turquie d’Erdogan, ce qu’exprime Le Temps de la manière suivante : « … C’est lui [Ghannouchi], en effet, le dépositaire, le garant même aux yeux d’Ankara et Doha de la sujétion d’Ennahdha à cet axe expansionniste, principalement dans ses visées sur la Libye. Pour Erdogan, Ennahdha en est la fenêtre d’attaque. Et son homme de confiance n’est autre que Ghannouchi. Il compte même sur lui pour tenir tête à Kaïs Saïed, surtout après que celui-ci eût parlé en France de légitimité temporaire du gouvernement El Sarraj. » (26). Pour être pertinente, cette critique suppose que Ghannouchi ait une capacité d’influence sur le président de la République tunisienne, au point d’inciter celui-ci à modifier les orientations de sa politique étrangère. Il s’agit de savoir ce que veut dire : « tenir tête ». S’il s’agit d’une simple capacité de persuasion exercée en tête-à-tête entre les deux hommes dans un bureau du palais de Carthage, on ne comprend pas très bien en quoi Ghannouchi aurait plus de poids pour plaider la cause de l’axe islamo-conservateur emmené par Erdogan qu’Erdogan lui-même.
S’il s’agit pour Ghannouchi d’utiliser la fonction parlementaire pour faire évoluer la législation dans un sens favorable à cet axe islamo-conservateur, c’est autre chose en effet. Ennahdha reconnaît une telle influence mais la juge positive pour la Tunisie ; c’est du moins ainsi que l’un de ses représentants, Imed Khmiri, présente les retombées de la visite à Istanbul du 11 janvier 2020 : « D’après lui, Ghannouchi aurait demandé à Erdogan de réviser le contrat commercial signé entre les deux pays afin de réduire le déficit grevant lourdement le budget commercial tunisien en faveur de la Turquie. » (36) Même si la teneur des entretiens est restée secrète, un lien peut être établi avec des faits qui les ont suivis et en premier lieu, l’initiative de réactiver les projets de coopération avec la Turquie et le Qatar mentionnés plus haut (accord avec Ankara du 27 décembre 2017, accord avec Doha pour l’ouverture du siège d’un fonds de développement qatarien). Pourtant, dans cette affaire, les critères formels qui définissent la diplomatie parallèle ne sont pas réunis : d’une part, cette action, d’ordre parlementaire, était bien du ressort du président de l’ARP qu’était Rached Ghannouchi ; d’autre part, elle ne contredisait en rien la politique de l’exécutif puisqu’elle consistait à proposer d’entériner une initiative, certes ancienne, prise par cet exécutif, même si, finalement, devant la polémique, le gouvernement demanda, le 28 avril le report de l’examen de ces deux textes (27). On voit que dans cette affaire l’action parlementaire de Ghannouchi pouvait réellement faire avancer les relations diplomatiques dans le sens de ses préférences, alors même que les critères formels définissant la diplomatie parallèle n’étaient pas réunis, ce qui montre une fois de plus l’insuffisance de cette définition.
Une preuve ? Le journal Le Temps n’y va pas de main morte ; selon lui, les deux projets d’accords la Turquie et le Qatar avaient pour « point commun » le « biffage pur et simple de la notion même de souveraineté nationale tunisienne ». En effet, toujours selon lui, en échange des investissements turcs en Tunisie, cette dernière acceptait que l’État turc utilise une partie de son territoire, et notamment de ses aéroports. « Il s’avère maintenant que contre ces deux textes, la Turquie a gagné une aisance qu’elle n’avait pas en territoire tunisien. Elle n’a pas perdu son temps, en ce sens qu’elle a multiplié les vols impromptus sur les aéroports tunisiens (le confinement contre le Covid-19 aidant) afin d’acheminer les moyens de son entrée en scène militaire en Libye. » (22). Dans une autre édition, le journal revient à la charge en entreprenant un récit de l’action internationale du président de l’ARP depuis son élection à ce poste à l’automne 2019 (23) : « ...les fruits de cette diplomatie parallèle ne tardèrent pas à “pleuvoir”. Un manège d’avions turcs qui demandent l’autorisation d’atterrissage après l’arrêt des réacteurs sur le tarmac des aéroports tunisiens (Djerba, surtout), avec des cargaisons adressées ouvertement au gouvernement Sarraj de Tripoli, désormais sous perfusion turco-qatarie, en armes et en troupes de mercenaires. » Selon des sources libyennes évoquées de manière imprécise par Le Temps, des unités militaires dirigées par Haftar auraient détruit, dans la semaine du 26 avril au 1er mai 2020, un convoi de munitions destinées aux milices de Sarraj à Tripoli et qui provenaient de la Tunisie (20). Cette fois-ci, on a quitté le domaine de la parole pure, pour entrer dans celui des actes concrets ; en d’autres termes, on a franchi plusieurs degrés sur l’échelle de liquidité des flux diplomatiques, passant de la liquidité la plus extrême (simple déclaration sans enjeu) à la relative solidité matérielle par laquelle un acte concret a des conséquences concrètes : accueillir sur des aéroports tunisiens des avions turcs pourrait, en permettant l’acheminement d’armes vers la Libye, changer le cours de la guerre. Le site tunisie-secret.com nomme précisément trois aéroports militaires tunisiens situés au sud du territoire, ceux de Borma, Tozeur et, « surtout », de Remada, qui seraient utilisé par les Turcs pour approvisionner le camp Sarraj en armes et en combattants. « Les aéroports de Burma, Tozeur et surtout Remada ont été mis à la disposition des cargos turcs et qataris pour acheminer du matériel et des djihadistes. » (37).Dans ces conditions, des représailles du camp Haftar deviennent concevables et justifiable cette crainte : « Un bombardement intensif de l’aéroport de Remada n'est pas du tout exclu » (37). Cela donne donc du poids à l’accusation formulée contre Ghannouchi d’atteinte à la sécurité nationale.
L’approche réaliste permettrait donc de conclure que l’existence d’un enjeu matériel est une condition nécessaire pour donner un sens au concept de diplomatie parallèle. Si la parole diplomatique n’a de sens que par les actes qu’elle promet (comme le papier-monnaie tirait jadis sa valeur du stock d’or auquel il s’adossait), aucune communication ne peut entrer en concurrence avec le message diplomatique officiel d’un Etat et, par conséquent, être qualifiée de « diplomatie parallèle », si elle n’est pas en mesure d’engager les moyens matériels de cet Etat. En d’autres termes, ou bien la diplomatie parallèle n’est qu’un mythe, ou bien elle est bien plus qu’une diplomatie, devant reposer, pour exister, sur un double pouvoir qui dépasse le seul domaine des affaires étrangères.
Etait-ce donc le cas en Tunisie en 2020 ? Rached Ghannouchi disposait-il donc d’un véritable pouvoir sur l’administration du pays, lui permettant de la contrôler au point d’être capable de mettre des aéroports à la disposition d’acteurs étrangers à l’insu de l’exécutif tunisien ?
Pour avancer prudemment sur cette question, notons d’abord que la réalité des faits reste incertaine. Cette information, contrairement à la révélation de la conversation téléphonique du 19 mai 2020[i], ne semble pas relayée par l’ensemble des médias. Sur les deux grands quotidiens francophones de la presse écrite tunisienne[ii], seul Le Temps mentionne cette utilisation illégale des infrastructures tunisiennes en nommant le seul aéroport de Djerba, sans préciser de dates et sans citer aucune source. Le site russe Sputnik relaie l’information en évoquant l’atterrissage sur l’aéroport de Djerba-Zarzis d’une cargaison uniquement sanitaire, à l’exclusion de tout transport d’armes (40). Il faut lui ajouter, il est vrai, le site tunisie-secret.com, qui, pour sa part, désigne d’autres aéroports comme mentionné plus haut, mais qui, assumant par ailleurs ouvertement son engagement anti islamiste[iii], ne trouve à citer pour appuyer ses propos que « des sources proches du maréchal Haftar », dont il serait excessif, on en conviendra, d’attendre et d’exiger une totale impartialité. Enfin, si l’Onu, par la voix de Stephanie Williams[iv], dénonce les violations de l’embargo sur les armes à destination de la Libye, son rapport, présenté lors de la réunion du Conseil de sécurité du 2 septembre 2020, ne fait aucune allusion à l’usage du territoire tunisien, alors qu’il précise que, depuis le 8 juillet, « environ 70 avions ont atterri dans les aéroports de l’est » en soutien à l’armée du maréchal Haftar, « pendant qu’une trentaine d’appareils ont été envoyés dans des aéroports de l’ouest de la Libye » en appui au gouvernement d’union GNA (8).
Si ces faits étaient avérés, si des aéroports tunisiens militaires (donc dépendant de l’État) avaient bel et bien été utilisés par des éléments étrangers, l’État tunisien serait engagé dans l’affaire ; reste à savoir ensuite lesquels de ses rouages en porteraient la responsabilité. Quand l’utilisation du territoire tunisien par la Turquie est reconnue comme un fait, elle est présentée de manière impersonnelle, pour ne pas dire pudibonde : « Des convois transitent par la Tunisie, des facilités ont été accordées à la Turquie. On finit par avoir, de facto, un alignement sur l’axe Ankara-Doha. », résume Kamel Jendoubi, une personnalité politique tunisienne de premier plan[v]. Ou bien, le gouvernement, voire le président, étaient au courant et ont donné le feu vert et dans ce cas, Ghannouchi n’a joué qu’un rôle subalterne, s’est comporté en simple ambassadeur, il n’y a donc pas de diplomatie parallèle ; ou bien les faits ont été organisés dans le secret, à l’insu du pouvoir exécutif, « moyennant », comme l’affirme le site tunisie-secret.com, « des complicités au sein de l’armée tunisienne », tandis que, toujours selon la même source, « quelques militaires tunisiens proches d’Ennahdha seraient directement impliqués dans le conflit libyen et aux côtés des troupes mobilisées par la Turquie ». Dans cette dernière hypothèse, la notion de diplomatie parallèle est à dépasser : non seulement s’expriment deux voix diplomatiques concurrentes, mais ces voix ne sont pas que des voix, ce ne sont pas seulement deux paroles diplomatiques rivales qui se font entendre, mais bel et bien des diplomaties en actes, traduisant deux politiques différentes pour un même territoire et révélant l’existence, au-delà d’une double diplomatie, d’une véritable dualité de pouvoirs. Le Temps n’hésita pas à titrer : « La bicéphalie s’installe en mode de gouvernement ! » (23)
Dans ces conditions, cette dualité comporte des conséquences matérielles qui justifient qu’elle soit prise au sérieux, y compris par les tenants de l’approche réaliste, et qui justifient par là-même le grief fait à Ghannouchi d’atteinte à la sécurité nationale. Pour ses opposants, il existe un réel danger de représailles à l’encontre de la Tunisie du fait de la rupture de son attitude de neutralité que ces démarches favoriseraient. Si elles avaient effectivement abouti à ce que transitent par le sol tunisien des moyens susceptibles de changer le cours de la guerre en Libye, il devenait plausible que, par simple volonté de corriger cette influence matérielle, Khalifa Haftar envisageât de neutraliser les aéroports tunisiens concernés.
Encore faudrait-il pour cela que le territoire tunisien comporte sur le plan stratégique une « valeur ajoutée » par rapport aux territoires voisins, qui le rende sinon indispensable, du moins particulièrement précieux, et son utilisation, particulièrement décisive. Or, les accusateurs de Ghannouchi eux-mêmes le démentent. « La Turquie a-t-elle vraiment besoin d’un “intermédiaire” pour pouvoir introduire ses “cargaisons” sur le sol libyen ? Bien sûr que non ! » (21), s’écrie Slim ben Yousssef dans les colonnes du Temps.
Et si la réponse était affirmative, il faudrait ajouter : Erdogan a-t-il vraiment besoin d’un intermédiaire pour pouvoir faire atterrir ses cargaisons sur le sol tunisien ? N’avait-il pas les moyens de l’imposer à la Tunisie sans passer par Ennahdha, et au président de la République sans passer par celui de l’ARP ? Le supposer consiste, il est vrai, à jouer à fond le jeu de l’approche réaliste, qui tend à réduire les relations internationales à de purs rapports de forces.
A condition de ne pas réduire cette notion à sa dimension militaire, mais de la définir comme un ensemble de moyens de pression, on peut l’appliquer en particulier aux relations entre la Turquie et la Tunisie, comme en témoigne M. Jalel Harchaoui, commentant la visite d’Erdogan à Tunis fin décembre 2019 : « “Quand Erdogan arrive dans la capitale tunisienne accompagné de son chef des renseignements et de hauts gradés, cela est fait sciemment” dans le but, (résume Le Monde), de forcer la main des autorités tunisiennes. » (6) Si les mots ont un sens, on comprend que les autorités turques ont « forcé la main » des autorités tunisiennes. La notion de rapport de forces ne saurait être plus littéralement exprimée, même si la nature des moyens de pression utilisés n’est pas explicitée. On comprend aussi et surtout que ce bras de fer s’est exercé sans l’intermédiation de M. Ghannouchi.
Mais la tradition réaliste comprend aussi une dimension rationaliste et fonctionnaliste, que résume la notion de « raison d’Etat » : c’est le paradigme utilitariste de l’intérêt qui suppose la rationalité des acteurs (cf. « Les raisons pour lesquelles... »). Selon cette approche, la diplomatie parallèle, comme tout phénomène, ne saurait exister si elle n’a pas de nécessité diplomatique, si elle ne remplit pas de fonction réelle dans ce domaine, si elle n’est pas dictée par la raison d’État.
Or, comme nous venons de le voir, il reste à prouver que le rôle d’intermédiaire joué par Rached Ghannouchi entre Ankara, Doha et Tunis était indispensable du point de vue de la raison d’État.
Nous aboutissons donc à un paradoxe. L’approche réaliste, dans le cas tunisien évoqué ici, a permis de montrer que la diplomatie parallèle peut avoir des conséquences éventuellement dramatiques pour le pays. En même temps, la même approche est incapable de rendre compte rationnellement de ce phénomène en le justifiant par ses fonctions.
Autrement dit, voilà un phénomène qui serait prouvé par ses conséquences, mais expliqué par aucune cause, qui n’existerait qu’à travers ses effets (sinon la croyance en ces effets), qui aurait des conséquences avant même d’avoir connu de naissance, une sorte d’existence sans essence.
On voit donc que la raison d’État est incapable de rendre compte de l’existence d’un phénomène pourtant bien réel. Or, si l’on reste attaché au théorème hégélien selon lequel le rationnel est réel et le réel est rationnel, on ne peut se satisfaire de ce constat. Voilà une contradiction qui doit nous inciter à dépasser tant l’approche idéaliste que l’approche réaliste.
En fait, dire que la raison d’État est incapable de justifier un phénomène ne signifie pas que ce phénomène échappe à toute rationalité. En l’occurrence, et comme les démarches qualifiées de diplomatie parallèle et les réactions à ces démarches ont bel et bien existé, on doit se pencher pour comprendre cette existence sur la rationalité des acteurs individuels qui en ont pris la responsabilité.
[i] Signalée aussi bien par Le Point (04/07/2020) que La Libre Belgique (03 juin 2020) ou que L’Economiste maghrébin (22/05/2020) pour ne citer que quelques exemples
[ii] Le Temps et La Presse de Tunisie
[iii] « Nous ne sommes pas neutres car l’obscurantisme islamiste est notre ennemi, la démocratie française notre modèle, le respect des droits de l’homme et l’humanisme laïc, les idéaux que nous défendons. » (37)
[iv] Emissaire par intérim de l’Onu pour la Libye après la démission de Ghassan Salamé en mars 2020
De la raison des Etats à la motivation des individus
D'abord un petit détour pédagogique
Par souci pédagogique appliqué à moi-même autant qu’au lecteur, je propose à ce dernier d’effectuer un petit détour par une illustration simple de diplomatie parallèle, un véritable cas d’école qui nous fait momentanément quitter le terrain tunisien : j’ai déjà fait allusion en début d’article à une série de contacts internationaux initiés par le Français Thierry Mariani avec le Syrien Bachar El-Assad dans la décennie 2010, qui peuvent être considérés comme relevant d’une diplomatie parallèle et qui ont souvent été dénoncés comme tels.
Dans ce cas la motivation individuelle des acteurs paraissait assez claire ; qu’elle fût idéologique ou stratégique, qu’elle visât à la réparation ou à la construction d’une image (internationale ou nationale), à l’accession ou au maintien au pouvoir, elle pouvait être déclinée en trois catégories d’enjeux selon les acteurs concernés :
Bachar El-Assad, dictateur syrien menant une guerre civile féroce dans son propre pays et soumis à une sorte de « quarantaine » diplomatique internationale, avait besoin de redorer son blason auprès de l’opinion publique mondiale. Chaque rencontre avec des individus du type de Thierry Mariani constituait une occasion de transmettre des messages à l’opinion (française en l’occurrence) avec la certitude qu’ils allaient être relayés avec zèle. Certes, l’antipathie des peuples étrangers ne l’empêchait nullement d’exercer son pouvoir et leurs sentiments étaient beaucoup moins déterminants que le rapport des forces militaires interne. Mais enfin, on sait que les dictateurs, libérés des échéances électorales, sont de ce fait d’autant plus disponibles pour penser sur le long terme… leur maintien au pouvoir. Ils savent que l’opinion des peuples qui élisent leurs dirigeants peut exercer une influence sur l’attitude de ces dirigeants à leur égard ; qu’ils exagèrent l’intérêt supposé de ces peuples pour la politique internationale ou qu’ils fassent faire jouer le principe de précaution ne change rien au résultat : quand la situation est désespérée, on ne se prive pas de la plus infime des contributions, surtout quand cela ne coûte que l’effort d’une réception ou d’un communiqué.
Quant à Thierry Mariani, en devenant en 2012, et jusqu’en 2017, député de la 11e circonscription représentant les Français de l’étranger, au nom desquels il était désormais autorisé à parler, il gagnait une légitimation en or pour ses nombreux voyages internationaux et, à l’occasion, pour ses contacts non moins internationaux. Il n’avait cependant pas attendu d’exercer ce mandat pour s’adonner à ce type de relations internationales, puisqu’il était député de la Drôme lorsqu’il se rendit en Irak en septembre 2002, se prétendant capable d’obtenir la libération les deux otages français Christian Chesnot et Georges Malbrunot. Il poursuivit ces voyages après 2017, en troquant sa casquette de représentant des Français de l’étranger contre celle de député européen, preuve que cette première couverture n’était pas une condition indispensable à l’exercice de la diplomatie parallèle. Au total, à la tête de délégations parlementaires proches sinon de l’extrême droite du moins de la droite extrême[i], il a rencontré pas moins de six fois le dictateur syrien entre 2014 et 2019. On chercherait en vain dans ces échanges quel message il pouvait faire passer à son interlocuteur, d’autant plus qu’il était clair pour tout le monde – dans un contexte de rupture des contacts diplomatiques - et en premier lieu pour cet interlocuteur, qu’il ne s’exprimait pas au nom de la France. On ne voit pas ce que le député pouvait apporter à Damas dans sa besace ; Il faut donc croire que la communication « diplomatique » entre ces deux acteurs était à sens unique. N’ayant rien à dire à ses interlocuteurs étrangers, Mariani acceptait en revanche de recevoir et de transmettre à l’opinion française des messages en phase avec son idéologie politique. L’essentiel semblait pour lui, par ses « déplacements provocateurs » (3) de défrayer la chronique, même s’il est difficile d’évaluer, pour en rendre compte, les parts respectives du narcissisme, de la tactique politique et d’un prosélytisme sincère, bien que peu regardant sur les moyens employés [ii].
[i] Longtemps étiqueté LR mais connu pour des positions proches de l’extrême droite, il rejoint en janvier 2019 la liste du Rassemblement National pour les élections au parlement européen. Il se faisait inviter en Syrie par l’association SOS-Chrétiens d’Orient , qualifiée de « groupuscule maurrassien » par Benoît Vitkine et Pierre Jaxel-Truer (33)
[ii] Irait-il jusqu’à instrumentaliser les propos de son illustre
hôte de Damas pour la cause de l’extrême droite française anti-immigration ? Dans un tweet, il fait dire à ce dernier : « La Syrie se bat pour sauver son identité. Je ne comprends plus l’Europe qui a renoncé à défendre la sienne
et qui accepte de se plier aux exigences de populations qu’elle accueille et qui veulent lui imposer un autre mode de vie. » (34)
Tunis, Ankara, Tripoli : revenons à nos moutons
Rien de tout cela, à part peut-être, on le verra, les considérations idéologiques, ne fonctionne dans le cas des relations nouées entre le Tunisien Rached Ghannouchi et le Turc Recep Tayyip Erdogan, ou encore entre le même Ghannouchi et le Libyen Fayez Sarraj, pour ne prendre que ces deux exemples.
Les deux interlocuteurs de Ghannouchi ont-ils besoin d’un soutien de l’opinion publique internationale ? S’en soucient-ils et comptent-ils sur lui pour le leur apporter ?
Il est vrai que le pouvoir de Fayez Sarraj était contesté en Libye, c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, en ce printemps 2020, le rapport des forces interne était militaire avant d’être électoral : l’urgence, pour Sarraj, était davantage de repousser les assauts des forces de Haftar que d’adresser des clins d’oeil à ceux des Libyens qui sympathisent avec les Frères Musulmans, en recevant un Tunisien de leurs amis en la personne du président d’Ennahdha ; encore eût-il fallu que le clin d’oeil fût perceptible par le grand nombre, au-delà de l’élite éclairée qui s’intéresse aux subtilités diplomatiques. La menace militaire et surtout l’efficacité de la réponse tout aussi militaire ne constituaient-elles pas alors un moyen plus sérieux de conforter le soutien de la population tripolitaine qu’il contrôlait ?
Si le pouvoir de Fayez Sarraj était disputé dans son pays, la comparaison avec Bachar El-Assad s’arrête là : celui-ci était placé au ban de la « communauté internationale » au moment où il recevait les délégations parlementaires de Mariani, tandis que Sarraj, lui, hissé par l’Onu au pouvoir à Tripoli, disposait de la légitimité internationale.
Rien de comparable non plus en ce qui concerne le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui, certes, partage avec Bachar El-Assad – par-delà leurs différences idéologiques - un certain goût pour la manière forte (disons-le comme cela), mais dont le pouvoir, non seulement n’est pas menacé par une guerre civile comme celle qui fit vaciller un temps le régime de Damas, mais se renforce au contraire depuis la tentative de coup d’État de l’été 2016 et la reprise en mains qui l’a suivie.
Et, en admettant qu’Erdogan soit soucieux de son image auprès de l’opinion publique internationale, on ne voit pas très bien en quoi la diplomatie parallèle lui permettrait de l’améliorer en Tunisie, puisque, à la différence d’Assad, qui, confronté à la fermeture des relations diplomatiques officielles avec la France, avait besoin d’interlocuteurs complaisants pour faire passer ses messages, il pouvait disposer des canaux officiels ouverts entre Ankara et Tunis, comme l’a montré sa visite du 25 décembre 2019 dans cette dernière capitale. Admettons que, comme on l’a supposé pour Sarraj (avant d’écarter l’hypothèse), Erdogan ait voulu s’adresser de manière privilégiée à une portion du peuple tunisien, celle qui sympathise avec l’Islam politique représenté par Ennahdha. On peut cependant s’interroger sur la pertinence, du point de vue turc, d’une stratégie qui consisterait à prêcher des convaincus. Si Erdogan avait voulu persuader les Tunisiens du bien-fondé de ses interventions militaires en Libye, n’était-il pas plus important pour lui de gagner la partie de l’opinion tunisienne qui ne lui était pas acquise d’avance[i] ?
Allons cependant plus loin et voyons si les enjeux de politique intérieure tunisienne nous éclairent davantage, au moins sur la conduite de Rached Ghannouchi. Car il faut noter tout de même en préambule que ce dernier éclairage, même éblouissant, ne saurait être suffisant tant il est vrai que, parallèle ou pas, la diplomatie se joue à deux au moins, et qu’il ne serait guère utile de comprendre la conduite d’une des parties si l’autre restait confuse.
L’hypothèse se heurte à un caractère récurrent du style « diplomatique » de Ghannouchi, opposé à celui de Mariani : autant ce dernier avait l’obsession de la publicité, autant c’est le souci de la discrétion, pour ne pas dire le goût du secret, qui caractérisait les démarches internationales du leader islamiste tunisien. Ce souci était d’ailleurs souvent partagé par ses interlocuteurs étrangers, du moins en ce qui concerne les fruits les moins liquides de la diplomatie parallèle. S’il était avéré que le territoire tunisien fut utilisé par le pouvoir d’Erdogan en Turquie au service de celui de Sarraj en Libye, ce serait une révélation qui en confirmerait le caractère clandestin : aucun des acteurs de l’affaire ne l’a crié sur les toits. Il est donc impossible de mettre ces actes au compte d’une volonté d’amélioration de l’image des uns comme des autres, interne ou internationale.
[i] Partie sans doute majoritaire puisque, même si le jeu des alliances permet aux Islamistes de contrôler la présidence du parlement et de participer au gouvernement dans des coalitions, les élections législatives. du 6 octobre 2019 n’ont désigné que 54 députés étiquetés Ennahdha sur 217.
Une première question
Mêmes lorsqu’elles étaient plus anodines que celles-ci (et les flux correspondants plus « liquides »), il semble que Rached Ghannouchi restait discret sur ses initiatives « diplomatiques ». En tout cas, ce n’est pas lui qui prit l’initiative de rendre publics les contacts qui ont fait scandale en 2020. La visite à Istanbul du 11 janvier fut ainsi dévoilée par l’agence de presse turque Anadolu (35), tandis que l’appel téléphonique du 19 mai 2020 fut révélé par son propre destinataire, sur la page Facebook du GNA, comme le précise le journal L’Economiste Maghrébin (28). Ce fait inspire une question immédiate, très simple et cruciale pour l’analyse de la rationalité des acteurs de la diplomatie parallèle : quel bénéfice politique pouvait tirer Rached Ghannouchi d’un message au contenu purement symbolique s’il était destiné à demeurer inconnu de tous, à la seule exception de son destinataire ?
Une première réponse...
La première réponse consiste à voir dans la discrétion un calcul politique assumé : ne pas avouer l’inavouable. Ainsi, pour L’Economiste Maghrébin, « ..., cet entretien téléphonique tombe au pire moment. Alors que la polémique enfle au Parlement quant aux relations ambiguës que le président du parti islamiste d’Ennahdha entretient avec des parties étrangères, notamment avec la Turquie d’Erdoğan. La preuve? M. Ghannouchi cache sciemment sa discussion avec Al-Sarraj. Laquelle n’a été annoncée ni sur la page officielle du Parlement, ni sur celle de l’intéressé. » Ghannouchi dissimulerait ses démarches parallèles en raison de leur caractère inavouable. Cela montre que l’intéressé, bien loin d’attendre de son action de diplomatie parallèle un quelconque bénéfice électoral interne, avait au contraire tout à craindre d’elle de ce point de vue. Il savait que ses agissements, s’ils pouvaient plaire à la partie de l’opinion publique qui lui était déjà acquise, risquait de braquer le reste de la population tunisienne. De fait, c’est bien ce qui semble s’être passé, si l’on en juge aux échos du débat parlementaire du printemps et de l’été 2020. Même si Ghannouchi a pu conserver la présidence de l’ARP et même si ses opposants n’ont pu réunir une majorité autour de la dénonciation de son action internationale, il suscite plus que jamais la méfiance du camp « laïc » tandis que l’affaiblissement personnel qu’il subit au sein même de son mouvement peut faire douter de l’efficacité de cette action pour séduire son propre camp. Il est vrai, cependant, que l’échec d’une stratégie ne prouve pas que cette stratégie n’ait jamais existé. Au passage, on voit que, pour poursuivre l’improbable comparaison Ghannouchi-Mariani, autant le second envisageait la diplomatie parallèle comme un outil utile pour atteindre ses buts politiques internes, autant le premier, pour atteindre les mêmes buts, devait au contraire cacher et nier la diplomatie parallèle, sans pour autant gagner beaucoup en faisant cela.
Cette première hypothèse laisse cependant subsister un mystère : s’il en était ainsi, si Ghannouchi, Sarraj et Erdogan étaient complices dans une entreprise qui devait rester secrète, on serait obligé de conclure que les deux derniers acteurs au moins ont une bien piètre capacité à tenir leur langue. Pourquoi ont-ils, eux, pris la responsabilité de révéler ces contacts ?
...qui suscite une deuxième question...
Cette deuxième question peut recevoir à son tour plusieurs réponses : la première consiste à douter de la sincérité des acteurs (de Ghannouchi en l’occurrence) et à parier sur la part de cynisme qui serait en eux. Selon cette hypothèse, la discrétion de Ghannouchi n’était pas sans arrière-pensée et le secret était un secret de polichinelle. Il n’aurait personnellement soigné la première et maintenu le second que parce qu’il savait que d’autres ne respecteraient pas la première et s’empresseraient de rompre le second. Cela suppose qu’il comptait tirer un bénéfice politique à la fois de son action et du dévoilement de cette action, à condition toutefois qu’elle ne fût pas dévoilée par lui-même. Sa propre discrétion, indispensable, n’était cependant pas pensable sans l’indiscrétion d’autrui. En quelque sorte une stratégie de la fausse modestie. Mais une telle stratégie (un peu tordue, on l’admettra) n’est plausible que si l’action en question est avouable, voire admirable, et de surcroît comme magnifiée par le fait que ce dévoilement provenait de l’indiscrétion d’autrui, couplée à sa propre discrétion. Or, ce n’était pas le cas, on l’a vu ; d’ailleurs, les médias tunisiens et les opposants tunisiens à Ghannouchi n’ont retenu derrière la discrétion qu’une volonté de dissimulation. C’est le manque de transparence qui fut dénoncé, non seulement par l’opposition parlementaire - « …S'adressant à une station de radio privée à Tunis, Moussi [i] a accusé le président du parlement de cacher des informations sur ses contacts aux députés et au grand public. » (39) -, mais, au-delà, par « de nombreux Tunisiens et Libyens », qui « ont critiqué le manque de transparence de ces interactions, qui coïncident avec l'escalade militaire dans l'ouest de la Libye. » (39)
Ghannouchi n’avait donc aucun intérêt à rompre le secret, ce qui ruine l’hypothèse du cynisme, du double jeu et de la stratégie de la fausse modestie. Parions donc au contraire maintenant sur sa sincérité. En particulier, le coup de téléphone du 19 mai 2020 était une démarche personnelle mue par un sincère sentiment de solidarité à l’égard d’une force politique et militaire qu’il soutenait en Libye, et peut-être par certains liens d’amitié qui pouvaient exister entre lui et son interlocuteur. Ces sentiments n’avaient besoin d’aucune publicité pour s’exprimer, ce qui explique la discrétion et le secret. Cette hypothèse est parfaitement plausible dès lors qu’on s’interdit de tronçonner l’Individu en séparant en lui l’homme de la fonction. Elle est très fructueuse puisqu’elle permet de comprendre à la fois le geste et la discrétion de ce geste.
[i] Abir Moussi, députée présidente du PDL (Parti Destourien Libre)
... et une troisième
Cette sincérité n’empêche pas la lucidité. Ghannouchi savait que tous les Tunisiens ne partageaient pas ses propres sentiments et qu’il n’avait donc aucun intérêt à rompre le secret. Il faut alors supposer que les seuls responsables de cette rupture étaient ses interlocuteurs. Pourquoi l’ont-ils commise ?
Il faut d’abord se demander jusqu’à quel point trahison il y eut, c’est-à-dire jusqu’à quel point la révélation de la rencontre d’Istanbul du 11 janvier 2020 avec Erdogan ainsi que de l’appel à Sarraj du 19 mai 2020 étaient voulues, pensées, préméditées. On exagère parfois la capacité des gouvernants - fussent-ils dictatoriaux – à contrôler tous les flux. Il est possible que le gouvernement turc ait la main mise sur l’agence de presse Anadolu ; cela signifie-t-il que les censeurs sont soucieux de contrôler absolument tous les flux d’informations qu’elle produit ? En ce qui concerne l’appel du 19 mai, si sa publication sur la page Facebook du GNA signale une volonté et ne peut être réduite à un acte manqué, l’implication personnelle de Fayez Sarraj n’en est pas pour autant prouvée, encore moins son intentionnalité, encore moins la conscience qu’il pouvait avoir des répercussions internes au débat politique tunisien que ce communiqué allait entraîner.
Peut-être faut-il admettre également qu’entre le tout et le rien, entre la préméditation, la planification et l’improvisation totale, il existe dans le jeu des acteurs une place pour la voie moyenne de la saisie des opportunités. Prenons l’exemple de Sarraj. Ne revenons pas sur les arguments qui font douter qu’il eût un véritable intérêt à utiliser Ghannouchi comme Assad utilisait Mariani : absence de besoin supplémentaire de reconnaissance, priorité au militaire au détriment du soft power dans le contexte libyen de 2020. Mais le recours à l’intérêt serait indispensable s’il s’agissait d’expliquer une initiative de sa part. Or, ce n’est pas le cas : ce qu’il s’agit de comprendre n’est que la réponse à une initiative : c’est Ghannouchi en l’occurrence, qui décida, le 19 mai 2020, de décrocher son téléphone ; peut-on considérer comme une initiative diplomatique le fait pour son interlocuteur d’accepter de prendre son appel ? Personne ne le prétend, il est vrai. Ce dont il est question, rétorquera-t-on, c’est du geste consistant à rendre publique cette conversation téléphonique. Il est facile de relativiser l’importance qu’avait pour Sarraj le soutien purement symbolique d’une personnalité d’un petit pays réputé neutre, personnalité certes influente dans ce pays mais qui pour autant n’en dirigeait pas officiellement la politique extérieure. Il reste que ce soutien, pour marginal qu’il fût, auprès duquel l’appui militaire de la Turquie apparaissait autrement plus décisif à court terme, n’avait aucune raison d’être négligé, dans la mesure où son coût - la production d’un communiqué - était encore plus dérisoire que son utilité. Sarraj était dans son rôle en faisant ou en laissant publier ce communiqué. En ne le faisant pas, il s’exposait, dénué de tout argument, au reproche de ne pas l’avoir fait, ou de ne pas l’avoir laissé faire, d’avoir négligé une brique, si minuscule fût-elle, dans la construction de son édifice.
Enfin, en admettant que ces révélations fissent réellement partie d’une stratégie conçue par Sarraj et Erdogan, on peut alors supposer que la trahison du secret était indispensable de leur point de vue pour donner un sens à ce qui n’en avait pas. En effet, il faut partir d’une évidence déjà mentionnée (cf. 5e exploration) : la parfaite transparence de la pensée des Etats qui, quoique parfaitement souverains à l’intérieur de leurs frontières, n’en constituent pas pour autant des boîtes noires. Les frontières sont encore moins étanches à l’information qu’aux marchandises. Une différence fondamentale entre personne morale et personne physique, c’est la possibilité de lire dans les pensées de la première.
Dans le cas tunisien, tous les interlocuteurs de M. Ghannouchi (Sarraj, Erdogan, les dirigeants qataris) connaissaient à la fois son engagement islamo-conservateur et son statut réel ; ils savaient bien en particulier qu’il n’avait pas le droit de s’exprimer au nom du peuple tunisien. Et c’est à l’aune de ces connaissances qu’ils recevaient ses messages. On pourrait d’ailleurs élargir ce constat à des protagonistes qui ne font pas partie de ses interlocuteurs directs. C’est ainsi que Khalifa Haftar ne pouvait sans mauvaise foi prendre ombrage des félicitations adressées par Ghannouchi à son rival Sarraj et surtout en faire supporter les conséquences à la nation tunisienne tout entière, dont il savait qu’elle ne s’exprimait pas officiellement par la bouche de Ghannouchi. Dans ces conditions, le souci de discrétion, pour ne pas dire la volonté manifestée par leur émetteur de garder secrets certains messages et certaines rencontres ne pouvait que diminuer leur valeur d’usage aux yeux de leurs récepteurs. Comment ces destinataires pouvaient-il croire que l’auteur s’exprimait au nom d’une entité qui dépassait sa propre personne (en l’occurrence l’État tunisien) si celle-ci n’était même pas au courant ? En rendant publics les messages discrets ou secrets qui leur étaient adressés, ils lançaient en quelque sorte un ballon d’essai, testant la réaction des représentants officiels des Etats au nom desquels leur interlocuteur prétendait parler.
En revanche, s’il est difficile de montrer que Rached Ghannouchi pouvait tirer un bénéfice politique de son action internationale, on ne peut pas en dire autant des autres acteurs tunisiens ; la polémique au sujet de cette action a dominé le débat parlementaire tunisien de l’été 2020, ce que regrette le chercheur Jalel Harchaoui en ces termes : « « Le fait que toute la nation soit obligée de se retrouver prise dans un débat de politique étrangère au milieu d’une crise économique sans précédent signifie que vous échouez fondamentalement dans votre expérience démocratique » (42). Le chercheur, adoptant une approche réaliste de la question libyenne souligne un paradoxe : « Ce qui se passe en Libye est une crise militaire qui est résolue en utilisant principalement des moyens militaires, ce qui signifie qu’effectivement, les Tunisiens, quoi qu’ils discutent, n’auront pas vraiment d’impact sérieux sur ce qui se passe. Cela ne devrait pas dominer le débat politique ».
Envoi
Les poètes ne terminent pas une ballade par une conclusion mais par un « envoi »[i].
Pareillement, sans certitudes, sans grands moyens d’investigation, je ne souhaite pas ici clore cette réflexion, mais plutôt l’ « envoyer », la confier à d’autres, à des mains plus expertes, pour qu’elles soient précisées, complétées, illustrées, amendées, discutées...
La diplomatie parallèle est un concept défini à partir du critère de la représentativité des acteurs qui prétendent parler au nom des Etats. Mais ce concept ne désigne une réalité tangible qu’à la double condition que les messages diplomatiques ainsi véhiculés aient une signification et un sens.
Du point de vue de la signification, la réalité d’une communication suppose que le contenu du message soit compris et admis par son récepteur : il n’y a de communication diplomatique parallèle que si le récepteur prend le contenu des messages au sérieux. Or, ces récepteurs savent que leur interlocuteur ne représente pas l’entité qu’ils prétendent représenter, ce qui incite à penser que la diplomatie parallèle est un mythe.
D’autre part, du point de vue du sens de la parole diplomatique, la rationalité réaliste privilégiant la raison d’État comme clef de compréhension des phénomènes interdit de concevoir une quelconque réalité des impacts de la diplomatie parallèle ; en effet, les Etats, sur la base de cette rationalité, ne sauraient engager entre eux des transactions qui les conduiraient à payer d’une monnaie réelle des flux frelatés ; ils ne sauraient accorder des concessions réelles en échange de paroles qu’ ils savent démonétisées parce que proférées par des individus usurpant l’identité de leurs interlocuteurs. Ils n’ont de raisons sérieuses de le faire que dans les cas critiques et exceptionnels où ces usurpateurs sont ressortissants d’un État qui a perdu le contrôle non seulement de sa politique extérieure mais aussi de son administration, au point qu’ils puissent l’utiliser dans des transactions relevant de la diplomatie parallèle. En d’autres termes, quand la diplomatie parallèle est avérée, c’est qu’il est trop tard et qu’elle a produit des métastases : quand la diplomatie est parallèle, tout est parallèle ; la diplomatie parallèle ne peut être que le prolongement international d’un pouvoir parallèle national ou local. Mais en dehors de ces situations extrêmes, les contacts relevant de la diplomatie parallèle n’ont pas d’utilité et les acteurs qui s’y adonnent n’ont pas de fonction ; or, si la fonction crée l’organe, inversement, l’organe disparaît avec la fonction.
Pourtant, en dehors de ces situations extrêmes, la diplomatie parallèle existe incontestablement en tant que représentation, puisque l’expression est employée. On ne peut sans scrupules se résoudre à passer à la trappe le phénomène que constitue cette représentation ; si l’on ne peut se contenter de la définition formelle de la diplomatie parallèle, on doit donc aussi dépasser l’approche réaliste, et on peut le faire en proposant que ce phénomène n’existe que parce que les acteurs jouent un rôle : ils savent que leurs interlocuteurs ne représentent rien, mais ils acceptent de leur répondre sur le même registre, par une parole qui n’engage à rien, sachant que leur interlocuteur à son tour est conscient de cela. Ce phénomène est doté du même type de réalité qu’une représentation théâtrale, qui a une existence en tant que telle indépendamment de l’existence réelle des personnages représentés ou, plus largement, d’une œuvre d’art, qui existe en tant qu’objet matériel (de toile ou de bronze par exemple) même si les sujets représentés sont morts ou n’ont jamais vécu.
Et pourquoi les acteurs individuels jouent-ils ainsi la comédie ? Certains d’entre eux y trouvent un intérêt personnel ou partisan dans une démarche de conquête du pouvoir politique, cet intérêt pouvant se comprendre sous deux formes : promotion d’une image personnelle auprès d’une opinion publique, instrumentalisation de relations internationales au profit d’une stratégie nationale, notamment électorale. Les autres ne font que répondre aux initiatives des premiers, ce qui les place dans la situation confortable de saisir des opportunités au service de leurs propres stratégies. Mais on a bien vu que ces explications ne rendaient pas compte de la totalité des situations.
Il est une dernière réponse qu’il ne faut pas négliger : si des acteurs jouent le jeu de la diplomatie parallèle alors qu’elle ne leur rapporte rien, à la manière dont un commerçant brade une marchandise, ou dont un banquier prête à taux négatifs, c’est aussi tout simplement parce qu’elle ne leur coûte pas davantage, voire moins encore, qu’elle ne leur rapporte. Si les actes diplomatiques, comme on l’a vu, s’inscrivent dans un continuum qui les lie et les oppose en même temps aux paroles comme à travers un fondu enchaîné, il convient maintenant, au moment de conclure cette réflexion et pour ouvrir la voie à son approfondissement ou à d’autres recherches, de distinguer et de lier de la même manière les actes et les gestes. L’acte a un caractère volontaire dont est dénué le geste, même si cette distinction est toute relative : ainsi peut-on dire que la décision d’établir une communication (par exemple passer un appel téléphonique) est un acte de par son caractère pro-actif opposé au caractère a contrario réactif du geste qui consiste à répondre à l’appel, à moins que la première n’ait répondu à une impulsion qui l’apparente au geste. Ainsi, lorsque la sonnerie du téléphone retentit, décrocher sans réfléchir est un geste dont il serait vain de chercher une signification et qui ne coûte a priori rien du tout, et sans doute moins que la décision de le laisser sonner sans répondre. C’est cette dernière qu’il faudrait paradoxalement considérer comme un acte signifiant une volonté de refuser le contact. La décision de révéler l’appel à des tiers, voire de le rendre public, se situe, sur l’échelle qui va du geste absolu à l’acte absolu, entre l’appel lui-même et la décision en retour prise par des tiers d’exploiter son existence à des fins politiques. On pourrait opérer le même classement en remplaçant ces éléments par d’autres : l’invitation à une visite diplomatique, la réponse à cette invitation, sa révélation pour le cas où elle devait initialement demeurer secrète, enfin l’ensemble des réactions que peuvent susciter l’invitation, son caractère initialement secret et sa révélation. Dans ce système, les actes les plus significatifs ne sont pas toujours ceux que l’on imagine.
Autrement dit, la question : « pourquoi les acteurs individuels jouent-ils la comédie » s’adresse à ceux qui posent des actes davantage qu’à ceux qui s’expriment par des gestes. Ces derniers ne relèvent pas vraiment de la comédie, soit parce qu’ils se définissent ainsi de par leur caractère réactif, soit parce qu’ils sont tout simplement mus par la sincérité. Il faut en effet réintroduire, même à dose homéopathique, l’hypothèse de la sincérité, ne serait-ce que pour remplir les interstices et les angles morts que l’insuffisance des hypothèses alternatives laisse à l’analyse.
Dans les relations internationales comme dans les relations interpersonnelles, certains gestes n’ont aucune raison d’être posés, mais personne ne comprendrait qu’ils ne le soient pas.
[i] Rappelez-vous Cyrano : « A la fin de l’envoi je touche ! »